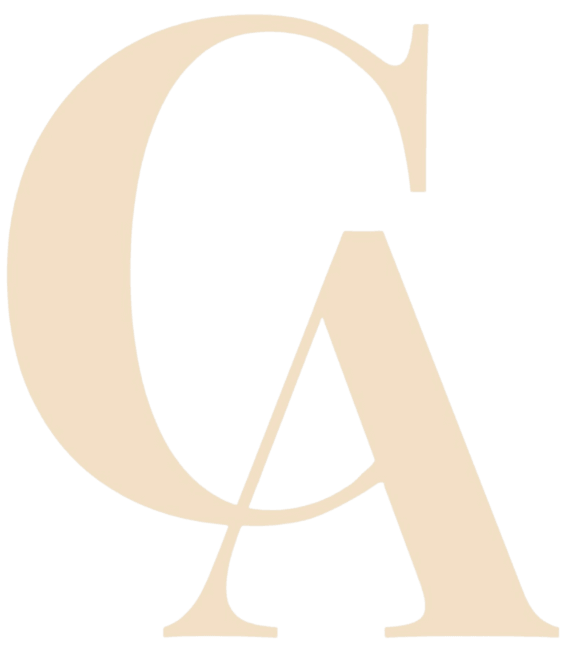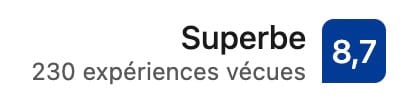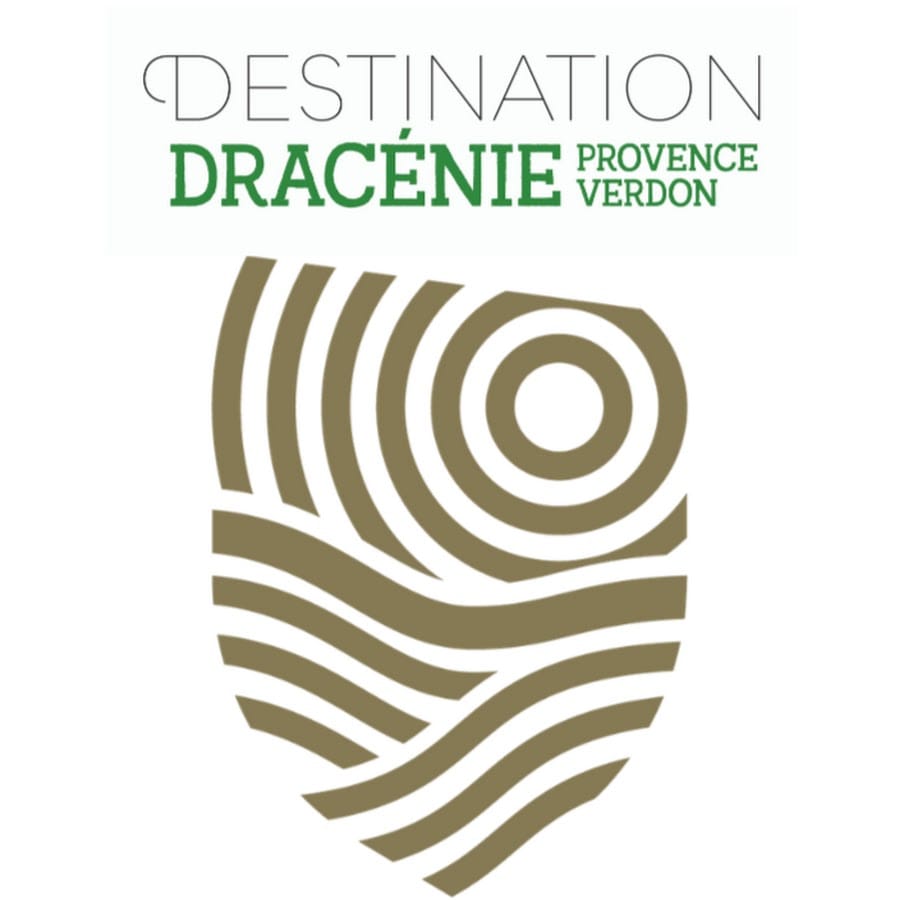Besoin d’une chambre ? Réservez en direct !
Où se baigner dans le Var : plages et rivières secrètes
Dès que l’on longe la côte ou que l’on remonte les vallons calcaires, le Var déploie une mosaïque d’eaux limpides qui va bien au-delà des clichés de sable blond. Les grandes étendues ne sont qu’une partie de l’histoire. À flanc de caps, au pied de falaises rouges, au creux de vallons ombragés, s’ouvrent des lieux dont la beauté se révèle lorsque l’on consent à marcher un peu, à partir tôt, à lire la météo du vent, et à respecter des sites que l’on voudrait parfois garder pour soi. Trouver la bonne anse, choisir le bon cours d’eau, savoir quand basculer d’un versant à l’autre de la presqu’île, c’est ainsi que l’on s’offre de vraies parenthèses d’eau claire dans le Var, en évitant la foule et en préservant la magie des lieux.
Les plages du golfe de Saint-Tropez sans la foule
Au sud du golfe, Ramatuelle porte des noms qui font rêver, mais il existe au-delà des images postales une réalité plus subtile pour qui sait s’écarter des axes principaux. La longue arche de sable connue pour ses établissements de plage n’est pas l’unique horizon. Dès que l’on suit le sentier du littoral au départ de l’Escalet, la côte s’effrite en criques rocheuses et en petites langues de sable brossées par des eaux qui ne prennent leur verre d’huile qu’au matin, avant que les bateaux ne parsèment la baie. Les jours de mer calme, les prairies de posidonies caressent vos chevilles quand vous vous engagez, et de minuscules piscines se forment à l’abri des écueils. Vers le Cap Taillat, la lumière blanche sur les roches blondes et le contraste du vert profond des fonds marins donnent au moindre bain une intensité presque insulaire. Il faut accepter la marche, apprivoiser les racines qui affleurent sous le pin d’Alep, et s’autoriser le temps de regarder en arrière : la bande de terre qui relie le cap dessine un paysage que l’eau façonne sans cesse, et dans lequel le baigneur s’inscrit avec délicatesse.

Plutôt que d’affronter la densité des accès routiers en milieu de journée, il est préférable d’arriver avant la chaleur et de se laisser guider par l’odeur de résine. En partant tôt, on s’offre la transparence la plus pure et l’impression d’être seul au monde. On découvre aussi des replis moins connus sur l’autre rive du golfe, du côté de Saint-Tropez village. Des plages comme les Salins s’étirent entre dunes et pins, avec des zones où la pente douce rassure les familles. En suivant les traces sableuses, on trouve d’autres échappées d’eau claire capables d’absorber les plus curieux sans perdre leur calme. La clé est de ne pas s’arrêter au premier parking, d’accepter de poursuivre à pied, et de s’éloigner des secteurs immédiatement visibles depuis la route.
Bormes-les-Mimosas et La Londe : petits paradis aux allures de carte postale
À l’ouest de la corniche des Maures, le littoral devient une succession de jardins littoraux où les plages se camouflent derrière des domaines boisés. À Bormes-les-Mimosas, Cabasson déroule une plage dorée au pied d’un fort qui veille, tandis que l’Estagnol forme une anse quasi lagunaire où l’eau se réchauffe vite et invite à lézarder dans la mer plus que face à elle. Les racines vernis du littoral épongent le tumulte et font écran aux bruits. À quelques enjambées, le Pellegrin prolonge l’expérience, avec des criques en enfilade qui se devinent en suivant le layon sableux. Les jours de brise légère, la surface a la douceur de la soie ; à l’annonce d’un vent forcissant, mieux vaut se replacer dans les anses protégées par les pointes rocheuses.
Ces plages ont une fréquentation notable en plein été, mais elles gardent leurs secrets pour ceux qui contournent les allées principales. Derrière l’enfilade de parasols, de petites avancées rocheuses se transforment en balcons sur l’eau, parfaits pour deux serviettes et un masque. Au cœur du jour, la lumière écrase les reliefs ; l’après-midi, elle descend et rétablit le contraste des fonds, un moment propice pour une baignade prolongée, en particulier fin août et début septembre lorsque la chaleur persiste et que la foule décroît. On n’y vient pas avec l’idée de cocher un lieu, mais avec le désir d’en comprendre les rythmes. C’est ainsi que l’on profite au mieux de ces havres et que l’on trouve des parenthèses de silence.

Le Lavandou et ses criques à fleur d’eau
Douze plages bordent Le Lavandou, mais seules quelques-unes livrent une sensation d’intimité que le sable étale peine à offrir. Saint-Clair s’impose par la qualité de son eau et la texture fine de son sable, plus clair que la moyenne. Au lever du jour, le clapot se retire, et les bancs de petits poissons s’agrègent le long de la première cassure. Un peu plus loin, Jean Blanc se cache derrière un rideau de végétation ; on y atteint une crique que l’on dirait taillée pour les bains sans gestes brusques, où la proximité du relief rassure et incite à prolonger. La Fossette, dans un autre registre, offre un équilibre entre espace et recoins. En suivant le sentier des douaniers, on multiplie les possibilités d’accès à des morceaux de côte que l’on n’aperçoit jamais depuis la chaussée.
L’intérêt de ces criques ne tient pas seulement à leur beauté. Elles sont des lieux d’apprentissage des éléments. L’absence de marée marquée ne signifie pas que la mer est immobile : un léger vent d’est mettra de petits rouleaux au bord, un mistral fort dégagera l’eau mais renforcera la dérive. On apprend vite à lire les lignes sur l’eau, à repérer les zones plus sombres où se concentrent les herbiers, et les langues plus claires où le sable s’est accumulé. C’est ce regard qui, au fil des bains, vous guide non pas vers la bonne plage, mais vers votre bonne plage du jour.
Hyères et la presqu’île de Giens : choisir le bon versant
Entre les deux tombolos qui dessinent deux immenses arcs, la presqu’île de Giens offre un cas d’école en matière de choix de versant selon le vent. Lorsque le mistral souffle, le côté oriental, vers La Capte et La Badine, offre des plans d’eau plus lisses, un sable qui s’enfonce lentement, et des couleurs laiteuses qui virent au turquoise au milieu de journée. À l’inverse, lorsque le Levant se lève, la face ouest, vers l’Almanarre, dévoile son visage de lagune aux allures caribéennes, avec des horizons plus clairs et, dès que le vent faiblit, une transparence exceptionnelle. Cette alternance offre au baigneur un terrain de jeu presque permanent, à condition de consulter la météo marine avant de choisir sa serviette.

Les bancs de posidonies, qui peuvent surprendre, ne sont pas des algues à bannir mais l’indicateur d’un milieu en bonne santé. Laissé sur place, ce feutrage végétal protège le sable de l’érosion et recueille une microfaune qui fait le bonheur de ceux qui s’équipent d’un masque. Sur le pourtour de la presqu’île, de petites calanques de calcaire affleurent aussi, notamment du côté des falaises qui regardent Porquerolles. Elles demandent un peu d’effort à la descente et des chaussures fermées, mais récompensent avec de l’eau claire, des paliers rocheux et des points d’entrée faciles pour l’eau.
De Toulon à Bandol : anses de roches et eaux claires
Dans l’aire toulonnaise, la corniche n’a rien perdu de son charme discret. L’anse Magaud, ourlée de galets qui roulent sous le pied, offre une clarté remarquable dès les premières chaleurs, tandis que Méjean, à quelques encablures, se love dans un amphithéâtre de rochers. L’ambiance de ces anses tient à la géologie : le galet filtre les remous, et les parois scellent le bruit. On s’y sent à l’écart du monde, même aux portes de la ville. Le matin, la mer s’y cueille en douceur ; en fin de journée, le soleil couchant dore la surface et aplanit tout, pour un dernier bain presque immobile.
Plus à l’ouest, Sanary et Bandol déclinent des criques et des baies comme Portissol et Renecros, qui mêlent urbanité et eau claire. En contournant les caps, on gagne des criques plus confidentielles où le sentier littoral prend des allures de balcon suspendu. À Saint-Cyr-sur-Mer, la calanque de Port d’Alon est une respiration entre pinède et mer, une anse profonde où l’eau reste fraîche et limpide même en été. Les roches arrondies invitent à de longues immersions ; un masque suffit pour se croire loin, très loin, alors que la route n’est jamais si distante.

Le littoral rouge de l’Estérel : falaises et criques secrètes
Vers Saint-Raphaël, la géologie change la donne. Le massif de l’Estérel plonge dans la mer en un puzzle de porphyres rouges. Entre Le Dramont, Agay et Anthéor, la côte s’entaille en criques profondes aux allures de calanques miniatures, où la roche rouille souligne le vert profond de l’eau. Le matin, la transparence est saisissante, et les jours de mer d’huile, les fonds s’offrent à plusieurs mètres. On y entre souvent par de petites cales, quelques marches taillées dans le rocher, ou une arche naturelle que l’on remarque à peine depuis la route. Ces criques, accessibles en suivant des escaliers parfois abrupts, récompensent l’effort par une baignade à l’écart, doublée d’un terrain de snorkelling généreux : poulpes, girelles et sars s’y partagent les anfractuosités.
L’Estérel se pratique avec tact. Les parkings sont comptés, la fréquentation se concentre aux points les plus visibles, et la corniche d’Or n’est pas conçue pour accueillir une file de voitures au-delà de l’aube. Le train littoral, qui dessert Le Dramont et Anthéor, devient une option précieuse pour enchaîner criques et bains sans les contraintes de la route. À pied, la lecture de la côte devient naturelle : chaque pointe coupe le vent différemment, chaque crique filtre l’agitation. On ne se contente pas d’échapper au monde ; on apprend à le contourner par le relief et la lumière.
Îles d’Or : plonger dans la carte postale
Porquerolles
Face à Hyères, Porquerolles condense tout ce qu’un baigneur peut espérer d’une île méditerranéenne accessible : une géométrie d’anses sablonneuses à l’est, des criques rocheuses à l’ouest, et une ambiance de village qui invite à ralentir. Les plages qui étirent leurs courbes au nord captent la lumière et offrent une eau incroyablement claire lorsque le vent tombe. La matinée s’y prête à des bains qui n’en finissent pas, alors que la foule tarde encore à s’amasser sur les liserés de sable. Plus loin, en se laissant guider par les pistes cyclables puis par les chemins, on rejoint des criques où la roche devient le théâtre de plongées masquées. Ces recoins se découvrent dans le silence, avec la conscience d’une île fragile. La fréquentation estivale y impose des gestes simples : venir tôt, repartir avec ses déchets, préférer la baignade à la musique, et laisser la mer parler à sa place.
Port-Cros
Plus sauvage, Port-Cros exige un autre tempo. Ici, pas de grandes nappes de sable, mais des anses minérales où la baignade prend un goût d’expédition douce. Les sentiers descendent vers des eaux d’une clarté peu commune, préservée par les règles du parc national. Le parcours sous-marin balisé, accessible depuis une anse réputée, donne le ton : on ne se contente pas de se mouiller, on observe, on ralentit, on prête attention. Le bain s’étire naturellement : l’eau fraîche maintient la vigilance et le relief retient le regard. Le soir, quand les bateaux repartent, il reste l’écho d’une journée passée dans une bulle hors du temps, où la mer est plus qu’un décor, une présence à laquelle on doit beaucoup.
Au large de Six-Fours : l’île des Embiez et les petites criques
L’île des Embiez, plus discrète, condense une autre facette. On y accède en quelques minutes, et l’on découvre un pourtour de criques taillées dans un massif calcaire piqueté de pins. L’eau y devient d’un vert profond, puis s’éclaircit au pied des dalles blanches. Les roches forment de petites terrasses naturelles, et les jours sans houle, on y glisse comme dans un bain taillé sur mesure. L’attrait, ici, tient à l’échelle : tout est proche, à taille humaine, mais jamais resserré au point d’étouffer. Le tour de l’île alterne douches de lumière et couloirs d’ombre, pour des bains qui s’improvisent au gré des angles.
Rivières et gorges secrètes du Var
Si le littoral occupe l’imaginaire, l’intérieur du Var offre une autre manière de se baigner, au fil de rivières qui creusent des gorges, de vasques ourlées de tuf, et de lacs assagis par des barrages. La clé, ici, est double : connaître les saisons de l’eau et respecter les règles locales. En été, les niveaux baissent, l’eau se réchauffe dans les vasques peu profondes et invite à la flânerie ; après un orage, la rivière devient une force à tenir à distance. Certaines zones emblématiques sont soumises à des interdictions de baignade pour des raisons de sécurité ou de préservation ; d’autres accueillent volontiers les baigneurs, à condition de rester discret et de laisser le site indemne.
L’Argens et le Vallon Sourn
Entre Châteauvert et Correns, l’Argens s’enfonce dans un défilé frais et sombre par endroits, bordé de falaises calcaires où l’on grimpe autant qu’on se mouille. Le Vallon Sourn, que les habitués prononcent à mi-voix, est une suite de vasques, de berges ombragées, et de passages plus profonds où l’on se laisse porter. La rivière, ici, n’est pas une ligne droite mais une succession de scènes. Le matin, un voile de brume flotte parfois au ras de l’eau, et la baignade commence par une acclimatation. En avançant de méandre en méandre, on trouve des coins où la berge s’abaisse, où la rive sablonneuse remplace le schiste lisse, et où l’eau prend un vert de bouteille apaisant. On s’y installe quelques heures, en veillant à laisser les accès libres et à ne pas encombrer les chemins agricoles qui mènent aux berges.
Les basses gorges du Verdon et le lac de Sainte-Croix
À la frontière nord du département, le Verdon se déploie en lacs aux teintes laiteuses et en gorges plus étroites. Sur la rive varoise du lac de Sainte-Croix, du côté d’Aiguines et des Salles, les plages alternent plages de galets et rubans de sable. L’eau saisit par sa fraîcheur relative, surtout en début de saison, mais récompense avec une clarté sans fard. En s’éloignant des points d’activité, on découvre des anses très calmes à l’aube, parfaites pour des bains silencieux quand la surface est encore immobile. Plus bas, dans les basses gorges du Verdon, accessibles depuis Quinson, les berges ombragées accueillent des baignades plus intimes. Les rebords rocheux forment des balcons d’où l’on glisse dans un courant lent, le regard accroché aux parois lissées par les siècles. La règle d’or reste la même : s’informer des débits et des consignes en vigueur, car un lâcher d’eau en amont peut changer la physionomie du courant.
L’Endre et les gorges de Pennafort
À l’est, près de Callas, l’Endre a sculpté des gorges plus secrètes, celles de Pennafort. L’eau y court entre des dalles rosées et des bassins naturels où la chaleur estivale se dissipe en quelques secondes. L’accès demande souvent une marche attentive, et les vasques les plus belles se méritent. On s’y baigne dans un murmure, car le site est resserré, et le moindre brouhaha se répercute. Les bassins s’enchaînent, liés par de petits toboggans rocheux qu’il convient d’aborder avec prudence. Cette rivière, peu connue en dehors des locaux, est le genre de trésor qui oblige à une présence légère : peu d’objets, des chaussures qui accrochent, et la conscience de passer après d’autres. En période de sécheresse, le débit chute ; on privilégie alors les zones ombragées et les heures fraîches pour profiter d’une eau qui redevient rare.
La Siagne et le pont des Tuves
À la limite orientale du Var, la Siagne coule en gorges vertigineuses sous un pont voûté qui relie Montauroux à Saint-Cézaire. Les abords du pont des Tuves dévoilent une eau d’un vert presque alpin, si claire qu’elle semble immobile. On s’y baigne par petites touches, le long de rives tapissées de feuilles et de galets moussus. La Siagne joue la carte de la discrétion : il faut descendre longtemps depuis le plateau, accepter de remonter en sueur, et copier la patience du cours d’eau. Quand on s’immerge, l’impression d’isolement est totale. La température saisit, mais le soleil qui filtre entre les branches compense. Les lieux étant très prisés en cœur d’été, la règle d’élégance consiste à venir tôt, à se fondre dans le décor, et à ne rien laisser derrière soi, pas même un empilement de cailloux.
Le Caramy et les reliefs calcaires
Plus central, le Caramy serpente en gorges aux abords de Tourves et de Carcès, où il creuse des vasques que les locaux savent lire selon la saison. Les berges alternent zones d’ombre dense et plages de graviers, parfaites pour s’asseoir le temps d’un bain prolongé. L’eau y garde une fraîcheur qui contraste avec l’air estival. Des passages plus encaissés obligent à une prudence accrue ; les sauts depuis les rochers sont à proscrire, la profondeur et les obstacles variant au fil des crues. Le bassin versant nourrit ici une succession de trous d’eau qui ne se ressemblent pas, et qui demandent un pas discret pour en profiter sans éroder des rives fragiles.
La Bresque à Sillans-la-Cascade
Le nom évoque immédiatement une image : un voile d’eau turquoise dans une cuvette de tuf, entourée d’un amphithéâtre végétal. Cet imaginaire a un prix : pour protéger le site de Sillans-la-Cascade et garantir la sécurité, la baignade est désormais interdite dans le grand bassin au pied de la chute. La magie n’est pourtant pas perdue pour qui respecte ces règles. En remontant le cours de la Bresque, en s’écartant des zones sensibles, on trouve des portions de rivière où l’eau s’étale entre de petites margelles naturelles. On s’y rafraîchit, on trempe les jambes, on se rince la nuque, et l’on garde le grand bassin pour ce qu’il est : une merveille à regarder. Cette manière de faire, qui consiste à préférer le regard à la conquête, sauve l’endroit et permet à chacun d’y revenir sans honte.
Choisir le bon moment et lire les éléments
La Méditerranée ne connaît pas de marées spectaculaires, mais elle n’est pas sans humeurs. Le vent décide bien des choses, et tout particulièrement autour des caps et sur les tombolos. Sur la presqu’île de Giens, on choisit son côté selon que le mistral (nord-ouest) ou le Levant (est) s’installe. Un souffle d’est mettra un clapot court sur les plages ouvertes de la côte orientale ; un mistral fort, s’il clarifie la vue, peut rendre la baignade inconfortable sur les faces exposées. Dans l’Estérel, la houle d’est, même modeste, suffit à transformer une crique parfaite en lave-linge ; le matin reste l’allié du baigneur qui cherche l’eau lisse. Dans les rivières, les pluies orageuses de fin d’été gonflent les cours d’eau en quelques heures, tandis que les lâchers de barrage dans le Verdon modifient les courants. L’information, ici, est votre meilleure alliée : consulter la météo marine, l’état des eaux de baignade publié par les communes, et les panneaux d’accès contribue à une baignade sereine.
Les méduses, au pic de l’été, ne sont pas un mythe. Elles suivent souvent les vents et les courants : un vent dominant peut les pousser vers une plage qu’on évitera ce jour-là au profit d’une anse voisine. Les herbiers de posidonies, parfois rejetés en banquettes, ne sont pas des déchets ; les communes les laissent volontairement en place sur certaines zones pour protéger le littoral. En rivière, la transparence ne garantit pas l’absence de courant ou de rochers affleurants ; entrer doucement, sonder le fond avec les pieds, et éviter les sauts maintiennent l’intégrité des chevilles.
Accès, stationnement et alternatives douces
Les plus beaux endroits supportent mal la saturation. En été, les parkings de bord de mer atteignent vite la jauge, et les temps d’attente ruinent le plaisir. Partir tôt est une évidence presque triviale, mais l’alternative douce fait une différence tangible. À Hyères, on rejoint facilement les îles en embarquant à la première heure et l’on loue des vélos pour élargir le rayon d’action. Dans l’Estérel, le train littoral dépose à deux pas des criques. Sur le golfe de Saint-Tropez, le sentier du littoral, bien balisé, se parcourt lentement, révélant des recoins que la voiture ignore. En rivière, la marche d’approche protège les lieux de la surfréquentation : un sac léger, des chaussures d’eau, et de l’eau à boire suffisent pour trouver votre coin de fraîcheur. Loin de diminuer le plaisir, ces contraintes le rehaussent, et transforment la baignade en petite aventure.
Préserver des lieux fragiles
La promesse du Var tient à des équilibres délicats. La posidonie fixe le sable ; les falaises, friables, s’écaillent si l’on grimpe hors des sentiers ; les tufs des vasques intérieures s’effritent au contact répété et aux piétinements. Préserver ces éléments, c’est prolonger le plaisir de tous. Sur le littoral, la règle est simple : serviette et affaires sur le sable ou les dalles, pas sur la végétation ; déchets repris avec soi ; musique tenue au casque ; chiens selon autorisations locales ; feux et barbecues proscrits. En rivière, on évite les shampoings et savons, même dits biodégradables, qui perturbent de petits biotopes clos. Les cailloux empilés ne sont pas des souvenirs inoffensifs : ils déplacent des micro-habitats et accélèrent l’érosion. Ces gestes, répétés, changent la physionomie d’un lieu ; refuser de les poser, c’est lui laisser sa force.
Des journées de baignade qui racontent un territoire
Il y a mille façons d’organiser une journée d’eau dans le Var sans se presser. Sur la côte, on commence à l’aube dans une anse tournée vers l’est, alors que la mer prend la lumière de face et la restitue en éclats presque métalliques. La baignade y est une mise en route, lente, attentive. On prend ensuite un chemin côtier, on s’égare volontairement dans les embranchements qui promettent un point de vue, et l’on recommence, plus tard, dans une crique orientée différemment, pour sentir le contraste. Le déjeuner se picore sur un rocher plat, les pieds encore salés, et l’après-midi trouve son épilogue dans une anse abritée, à l’heure où la foule se retire. En fin de journée, la mer devient un miroir, et l’on prolonge jusqu’au dernier rayon, sans chercher autre chose que la sensation d’un corps porté.
À l’intérieur, la logique est autre. On s’engage en milieu de matinée dans une gorge ombragée, lorsque l’air s’est réchauffé mais que les pierres gardent la fraîcheur de la nuit. La première immersion saisit, fait battre le cœur, vide la tête. On s’installe sur une dalle, on lit, on écoute. En avançant, on découvre un bassin plus profond, puis un rivage de gravier où l’eau murmurante invite à la sieste. On prend la mesure des reliefs, on respecte les climats du lieu : les passages encordés, les pierres glissantes, la présence d’autres baigneurs venus chercher la même chose. Le retour se fait plus tard, au pas, comme pour prolonger la sensation d’eau sur la peau. Le soir, l’odeur de la garrigue sèche accompagne le chemin, et la baignade s’inscrit dans la mémoire comme un moment de pure coïncidence entre le corps et le terrain.
Conseils pratiques pour des baignades sereines
Quelques habitudes transforment l’expérience. L’eau, en quantité, s’impose ; les coups de chaleur s’attrapent vite au sortir d’un bain. Une protection solaire appliquée en amont, et plutôt des vêtements légers, évitent les films flottants à la surface de l’eau. Des chaussures d’eau ou des sandales solides changent la vie sur les roches du littoral comme sur les galets des rivières. Un petit sac étanche garde clés et téléphone à l’abri d’un clapot inattendu. La consultation des sites municipaux et des applications qui recensent les fermetures temporaires de baignade protège d’une mauvaise surprise après de gros orages. On se souvient aussi que la Méditerranée, si elle paraît douce, n’est jamais une piscine : les courants de retour existent, même s’ils sont plus rares, et l’on évite de se placer au droit des enrochements où l’eau se recale avec force. En rivière, la prudence face aux sauts s’impose, et l’on n’oublie pas qu’une vasque claire peut masquer un arbre ou une pierre affleurante.
Le mot de la fin : chercher, lire, respecter
Se baigner dans le Var, c’est accepter que la beauté se mérite autant qu’elle se cueille. Sur la côte, les criques ne livrent leur secret qu’à ceux qui marchent à la fraîche, qui écoutent le vent et qui s’inclinent devant la posidonie. À l’intérieur, les rivières racontent l’eau autrement, en la déposant sur la peau comme une vérité simple. Les deux univers demandent la même chose : une attention aux signes, une curiosité sans impatience, et une forme d’humilité. Le plaisir de l’eau claire n’est pas seulement un décor ; c’est un échange, dans lequel chaque geste compte. En revenant de ces baignades, on rapporte plus qu’une image. On emporte une façon de faire qui, si l’on y prend garde, prolonge le plaisir de tous ceux qui viendront ensuite glisser dans la même eau.